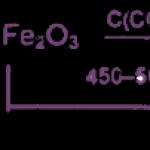Conditions économiques en temps de guerre. La crise générale qui a frappé l’Union soviétique à la fin des années 1980 était principalement due à la faiblesse de son économie, détruite par des dépenses militaires insoutenables. Au cours des 25 dernières années de l'existence de l'URSS, nous avons vécu non seulement dans une économie de guerre, mais dans une économie de guerre. On a caché au peuple qu'au cours de cette période, plus de mille cinq cent milliards de roubles ont été dépensés pour les besoins militaires.
Toute notre propagande officielle au cours des « années de stagnation » a claironné au monde entier que « l’URSS est un bastion de la paix et du socialisme ». Pendant ce temps, les « champions de la paix » ont réalisé et dépassé les plans de production d'armes et d'équipements militaires, ont construit des chars et des avions en 2 ou 3 équipes, ont lancé 5 à 6 avions militaires dans l'espace chaque mois, ont fait exploser 15 à 20 bombes atomiques ou à hydrogène. chaque année et le plus grand vendeur d'armes au monde. Selon les experts américains, il existe au total environ 50 millions de fusils d'assaut Kalachnikov et environ 8 millions d'unités du fusil américain M-16 dans différents pays du monde.
Confrontation entre les États-Unis et l'URSS. Les guerres régionales et les conflits militaires utilisant des armes conventionnelles se sont poursuivis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Dans un certain nombre de cas, ils étaient le résultat d’affrontements militaires entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l’URSS, dans diverses parties du globe. Au début des années 1990, le nombre total de morts lors de ces guerres régionales atteignait 17 millions de personnes.
Nos dirigeants juraient verbalement jour et nuit qu'ils étaient pacifiques, mais en réalité tout n'était pas ainsi. Le socialisme de Staline, avec son caractère belliqueux, a toujours semé la peur chez les gens et a constitué une menace pour le monde entier. Le stalinisme et le néo-stalinisme sont des coups de sabre et des ingérences dans les affaires intérieures non seulement des États souverains limitrophes, mais aussi des pays d’outre-mer lointains.
Chronique des actions militaires de l'URSS. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales actions militaires menées à la fois directement par l'URSS et avec sa participation contre ses voisins les plus proches pour « nos intérêts » dans les décennies d'après-guerre.
- 1948 – « siège » de Berlin-Ouest. Blocage par les troupes soviétiques des liaisons de transport terrestre entre l'Allemagne et Berlin-Ouest.
- 1950-1953 - Guerre de Corée.
- 1953 – Les troupes soviétiques répriment le soulèvement en RDA.
- 1956 – Les troupes soviétiques répriment la révolution anticommuniste en Hongrie.
- 1961 - construction du mur de Berlin de 29 kilomètres en une nuit du 13 août. Crise berlinoise.
- 1962 - importation secrète à Cuba de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques à tête nucléaire. Crise des Caraïbes.
- 1967 - participation de spécialistes militaires soviétiques à la « guerre des sept jours » entre Israël et l'Égypte, la Syrie et la Jordanie.
- 1968 - Invasion des troupes de l'URSS, de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie en Tchécoslovaquie.
- 1979 - entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Le début de la guerre afghane de dix ans.
Pays où les soldats soviétiques ont combattu. Outre les opérations militaires connues dans le monde entier avec la participation officielle de l'armée soviétique, soit sous forme de « campagnes de libération », soit dans le cadre d'un « contingent limité de troupes », nos « guerriers internationalistes » en tenue civile ou dans l'uniforme des « indigènes », ou dans des chars et des avions repeints étaient dans l'armée en Corée du Nord, au Laos, en Algérie, en Égypte, au Yémen, au Vietnam, en Syrie, au Cambodge, au Bangladesh, en Angola, au Mozambique, en Éthiopie, au Nicaragua, au Honduras, en El Salvador, Cuba. Bolivie, Grenade – au total plus de vingt pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.
Le 21 mai 1991, le journal Krasnaya Zvezda a publié, avec l'autorisation du ministère de la Défense de l'URSS, une liste loin d'être complète des pays où des militaires soviétiques - « guerriers internationalistes » - ont pris part aux hostilités, indiquant l'heure des combats. . Il est présenté ci-dessous dans le tableau 1 avec l'ajout d'une colonne sur la dette de ces pays envers l'Union soviétique pour l'assistance militaire.
Le prix de « l’aide désintéressée ».« Aide désintéressée », selon le ministre des Affaires étrangères de l'URSS E.A. Chevardnadze, qui s'est exprimé au XXVIIIe Congrès du PCUS, s'est élevé à 700 milliards de roubles sur 20 ans. Cela signifie que nous gaspillons chaque année 35 milliards de roubles uniquement en fournitures militaires pour les anciens pays socialistes et les pays du tiers monde afin de les convertir à la foi communiste.
Les dons à « nos amis » avec des avions, des chars, des hélicoptères, des missiles, des mines ont coûté trop cher à l'URSS : l'Egypte, la Somalie, le Ghana, le Congo, la Grenade, ayant marché un peu côte à côte avec nos spécialistes militaires « sur le chemin de l'orientation socialiste », est revenu sur la voie du développement normal. En février 1990, à la suite d’élections générales libres et de la défaite des sandinistes aux élections, le Nicaragua s’est détourné de « notre » voie. Eh bien, lorsque l’URSS a disparu, presque tous les autres régimes « d’orientation socialiste » ont été vaincus ou transformés.
Des dizaines de milliers de soldats soviétiques en civil ont posé des mines, tendu des embuscades et brandi des kalachnikovs et le drapeau de la lutte de libération nationale contre « l’impérialisme mondial » dans des dizaines de pays du « tiers-monde ». Tous ces volontaires ne sont pas rentrés chez eux sains et saufs. Beaucoup d’entre eux étaient destinés au sort du « soldat inconnu » dont la tombe anonyme se trouvait soit dans la jungle africaine, soit dans les sables du Sahara, soit sur le plateau du Golan.
Tableau 1
Participation du personnel militaire de l'URSS aux hostilités
après la Seconde Guerre mondiale
| Pays dans lesquels le personnel militaire soviétique était stationné | Temps de combat (mois, années) | La dette du pays envers l'Union soviétique, milliards de roubles |
| Corée du Nord | Juin 1950 - juillet 1953 | 2,2 |
| Laos | 1960-1963, août 1964-novembre 1968, novembre 1969-décembre 1970 | 0,8 |
| Algérie | 1962—1964 | 2,5 |
| Egypte | 18 octobre 1962 - 1er avril 1963, 1er octobre 1969 - 16 juin 1972, 5 octobre 1973 - 1er avril 1974 | 1,7 |
| Yémen | 18 octobre 1962 – 1er avril 1963 | 1,0 |
| Viêt Nam | 1er juillet 1965 – 31 décembre 1974 | 9,1 |
| Syrie | 5-13 juin 1967, 6-24 octobre 1973 | 6,7 |
| Cambodge | Avril-décembre 1970 | 0,7 |
| Bangladesh | 1972-1973 | 0,1 |
| Angola | Novembre 1975-1979 | 2,0 |
| Mozambique | 1967-1969, novembre 1975-novembre 1979 | 0,8 |
| Ethiopie | 9 décembre 1977 – 30 novembre 1979 | 2,8 |
| Afghanistan | Avril 1978-mai 1991 | 3,0 |
| Nicaragua | 1980-1990 | 1,0 |
Cette conclusion est confirmée par les données de la gestion financière du ministère de la Défense de l'URSS pour 1989. 2,4 milliards de roubles ont été alloués aux prestations de retraite de 1 million 280 000 anciens combattants des forces armées et participants à la guerre. Parmi ces anciens combattants, 832 000 perçoivent une pension d'ancienneté. 111 000 personnes ont reçu une pension d'invalidité - parmi lesquelles ceux qui ont « reniflé de la poudre à l'étranger » et, enfin, 239 000 personnes ont reçu une pension pour la perte de leur soutien de famille - ces « soldats inconnus » aux tombes anonymes.
"Des volontaires sous la contrainte." Les «volontaires contraints» survivants ont signé aux «autorités compétentes» un engagement à ne pas divulguer de «secrets d'État» - concernant «leurs voyages d'affaires» en Somalie, au Mozambique, à Grenade, etc. Ce n'est que le 30 juin 1989 que le voile du secret entourant nos « guerriers internationalistes » fut légèrement levé et le gouvernement décida de leur étendre les avantages et avantages prévus pour les participants à la Grande Guerre patriotique et pour les militaires ayant servi dans la République de Afghanistan.
L'URSS en tant que fournisseur d'armes. Au cours des 25 dernières années de son existence, l’Union soviétique était le plus grand fournisseur d’armes au monde. La part de l'URSS dans le volume total des livraisons d'armes à tous les pays du monde a atteint 40 % au début des années 1980, et pour certains types d'équipements et d'armes militaires, elle a atteint 50 % (fusils d'assaut et chars Kalachnikov). Au début des années 1980. 25 % de toutes les armes et équipements militaires produits en URSS ont été exportés. Nos concurrents - les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine - fournisseurs d'armes reconnus - sont loin derrière. Par exemple, en 1985, la part des États-Unis dans l'approvisionnement mondial en armes était de 27 %, la France de 12 %, la Grande-Bretagne de 5 %, la Chine de 3 %.
Nombres. Une analyse des approvisionnements en produits de tous les complexes industriels (métallurgie, carburant et énergie, ingénierie, etc.) pour les entreprises du complexe militaro-industriel, la science militaire, les forces armées, le KGB, le ministère de l'Intérieur et d'autres calculs spéciaux ont montré qu'en 1989 "Pour la défense", 485 milliards de roubles ont été alloués. Sachant que les entreprises du complexe militaro-industriel ont produit pour 30 milliards de roubles des biens de consommation (téléviseurs, radios, magnétophones, etc.), nous pensons que l’industrie a dépensé 455 milliards de roubles pour la défense.
Ajoutons à ce montant de dépenses les fonds alloués à la construction militaire - au moins 10 milliards de roubles et à la science militaire - au moins 15 milliards de roubles. Nous constatons que les dépenses militaires totales de l’URSS (hors transports et communications) se sont élevées à pas moins de 480 (455 + 10 + 15) milliards de roubles en seulement un an.
Selon les données officielles, en 1989, le produit national brut était de 924 milliards de roubles et le revenu national généré était de 656 milliards de roubles. Ensuite, nos dépenses de « défense » ont atteint des chiffres ahurissants : 51,9 % du produit national brut ou 73,1 % du revenu national généré, ce qui confirme l'effondrement complet de l'économie soviétique, mise à rude épreuve par des dépenses militaires insoutenables.
Cette course aux armements insensée au cours du dernier quart de siècle de l'existence de l'URSS et l'assistance imprudente (plutôt criminelle envers son propre peuple) à tout le monde et à tout ont contribué à la ruine de notre pays et à l'appauvrissement complet du peuple.
Pour la période de 1945 au début du 21e siècle. Il y a eu plus de 500 guerres locales et conflits armés dans le monde. Ils ont non seulement influencé la formation des relations entre les pays directement situés dans les zones de conflit, mais ont également affecté la politique et l'économie de nombreux pays du monde. Selon de nombreux politologues, la probabilité de nouvelles guerres locales et de nouveaux conflits armés non seulement persiste, mais augmente également. À cet égard, l'étude des raisons de leur apparition, des méthodes pour les déclencher, de l'expérience dans la préparation et la conduite des opérations de combat et des particularités de l'art militaire dans celles-ci acquiert une importance particulièrement pertinente.
Le terme « guerre locale » fait référence à une guerre impliquant deux ou plusieurs États à l'intérieur des frontières de leurs territoires, limitée dans son objectif et sa portée du point de vue des intérêts des grandes puissances. Les guerres locales sont généralement menées avec le soutien direct ou indirect des grandes puissances, qui peuvent les utiliser pour atteindre leurs propres objectifs politiques.
Un conflit armé est un conflit armé d'une échelle limitée entre des États (conflit armé international) ou des parties opposées sur le territoire d'un État (conflit armé interne). Dans les conflits armés, la guerre n’est pas déclarée et aucune transition vers la guerre n’est effectuée. Un conflit armé international peut se transformer en guerre locale et un conflit armé interne en guerre civile.
Les plus grandes guerres locales de la 2e moitié du 20e siècle, qui ont eu un impact significatif sur le développement des affaires militaires, comprennent : la guerre de Corée (1950-1953), la guerre du Vietnam (1964-1975), la guerre indo-pakistanaise. (1971), les guerres israélo-arabes, la guerre d'Afghanistan (1979-1989), la guerre Iran-Irak (1980-1988), la guerre du Golfe (1991), les guerres de Yougoslavie et d'Irak.
1. Bref aperçu des guerres locales et des conflits armés
Guerre de Corée (1950-1953)
DANS Août 1945 L'Armée rouge libère la partie nord de la Corée des occupants japonais. La partie de la péninsule située au sud du 38e parallèle est occupée par les troupes américaines. À l'avenir, il était prévu de créer un État coréen unifié. L’Union soviétique retire ses troupes du territoire nord-coréen en 1948. Cependant, les États-Unis ont poursuivi leur politique de division du pays. En août 1948, un gouvernement pro-américain dirigé par Syngman Rhee est formé en Corée du Sud. Au nord du pays, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) est proclamée à l'automne de la même année. Les gouvernements de la RPDC et de la Corée du Sud pensaient que la création d’un État uni sous leur autorité n’était possible qu’en détruisant le régime hostile dans une autre partie de la Corée. Les deux pays ont commencé à créer et à développer activement leurs forces armées.
À l'été 1950, la taille de l'armée sud-coréenne atteignait 100 000 personnes. Il était armé de 840 canons et mortiers, de 1 900 fusils antichar bazooka et de 27 véhicules blindés. De plus, cette armée disposait de 20 avions de combat et de 79 navires de guerre.
L'Armée populaire coréenne (KPA) était composée de 10 divisions de fusiliers, d'une brigade de chars et d'un régiment de motocyclettes. Il disposait de 1,6 mille canons et mortiers, 258 chars et 172 avions de combat.
Le plan de guerre américano-sud-coréen était d'encercler et de détruire les principales forces de l'Armée populaire coréenne dans les régions de Pyongyang et au sud de Wonsan en attaquant les forces terrestres depuis le front et en débarquant des troupes à l'arrière, après quoi, en développant une offensive vers le nord. , atteindre la frontière avec la Chine .
Leurs actions étaient prêtes à soutenir 3 divisions d'infanterie américaines et 1 division blindée, un régiment d'infanterie distinct et un groupe de combat régimentaire faisant partie de la 8e armée américaine, basée au Japon.
Au début du mois de mai 1950, le gouvernement de la RPDC reçut des informations fiables sur l'agression imminente. Avec l'aide d'un groupe de conseillers militaires soviétiques, un plan d'action militaire a été élaboré, qui prévoyait de repousser les attaques ennemies puis de lancer une contre-offensive. L'URSS a fourni à la Corée du Nord une aide matérielle, notamment du matériel et des armes lourdes. Le déploiement avancé des troupes le long du 38e parallèle a permis d'atteindre un équilibre des forces et des moyens favorable à l'APK. Le passage des troupes de l'APK à l'offensive du 25 juin 1950 est considéré par de nombreux historiens comme une mesure nécessaire en lien avec les nombreuses provocations militaires de la Corée du Sud.
Les opérations militaires de la guerre de Corée peuvent être divisées en quatre périodes.
1ère période (25 juin - 14 septembre 1950). Le matin du 25 juin 1950, le KPA passe à l'offensive. Sous la pression américaine et en l’absence d’un représentant soviétique, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé la création de troupes de l’ONU pour « repousser l’agression ». Le 5 juillet, des unités de la 8e armée américaine, sous drapeau de l'ONU, entrent dans la bataille contre le KPA. La résistance ennemie a augmenté. Malgré cela, les troupes de la KPA ont poursuivi leur offensive réussie et ont avancé de 250 à 350 km vers le sud en un mois et demi.
La domination de l'aviation américaine dans les airs a contraint le commandement de la KPA à se tourner de plus en plus vers des opérations de nuit, ce qui a affecté négativement le rythme de l'offensive. Le 20 août, l'offensive du KPA était stoppée au détour de la rivière. Naktong. L'ennemi a réussi à conserver la tête de pont de Busan, au sud de la péninsule coréenne.
2e période (15 septembre - 24 octobre 1950). À la mi-septembre, l'ennemi avait transféré jusqu'à 6 divisions américaines et une brigade britannique vers la tête de pont de Busan. Le rapport de force a changé en sa faveur. La 8e armée américaine comprenait à elle seule 14 divisions d'infanterie, 2 brigades, jusqu'à 500 chars, plus de 1,6 mille canons et mortiers et plus de 1 mille avions. Le plan du commandement américain était d'encercler et de détruire les principales forces de la KPA en frappant les troupes depuis la tête de pont de Busan et en lançant un assaut amphibie dans la région d'Incheon.
L'opération débute le 15 septembre par un atterrissage amphibie derrière les lignes KPA. Le 16 septembre, les troupes de la tête de pont de Busan passent à l'offensive. Ils ont réussi à percer les défenses de la KPA et à développer une offensive vers le nord. Le 23 octobre, l'ennemi s'empare de Pyongyang. Sur la côte ouest, les troupes américaines ont réussi à atteindre la frontière sino-coréenne fin octobre. Leur avancée ultérieure a été retardée par la défense obstinée des unités de la KPA et des partisans opérant derrière les lignes ennemies.
3ème période (25 octobre 1950 - 9 juillet 1951). Depuis le 19 octobre 1950, les Volontaires du peuple chinois (CPV) ont pris part aux hostilités aux côtés de la RPDC. Le 25 octobre, les unités avancées du KPA et du CPV lancent une contre-attaque contre l'ennemi. Développant l'offensive qui avait débuté avec succès, les troupes du KPA et du CPV ont débarrassé tout le territoire de la Corée du Nord de l'ennemi en 8 mois d'hostilités. Les tentatives des troupes américaines et sud-coréennes de lancer une nouvelle offensive dans la première moitié de 1951 n'ont pas abouti. En juillet 1951, le front se stabilise le long du 38e parallèle et les belligérants entament des négociations de paix.
4ème période (10 juillet 1951 - 27 juillet 1953). Le commandement américain a perturbé à plusieurs reprises les négociations et a repris les hostilités. Les avions ennemis ont mené des attaques massives contre des cibles arrière et des troupes nord-coréennes. Cependant, en raison de la résistance active et de la ténacité des troupes de la KPA et du CPV en défense, les prochaines tentatives offensives de l’ennemi n’ont pas abouti.
avait. La position ferme de l'URSS, les lourdes pertes des troupes de l'ONU et les demandes croissantes de la communauté mondiale de mettre fin à la guerre ont conduit à la signature d'un accord de cessez-le-feu le 27 juillet 1953.
En conséquence, la guerre s'est terminée là où elle avait commencé - sur le 38e parallèle, le long duquel passait la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L’un des résultats militaro-politiques importants de la guerre a été que les États-Unis et leurs alliés, malgré tout leur énorme potentiel, ont été incapables de gagner une guerre contre un ennemi beaucoup moins équipé techniquement, comme l’armée nord-coréenne et les volontaires chinois.
Guerre du Vietnam (1964-1975)
La guerre du Vietnam a été l’un des conflits armés les plus importants et les plus longs après la Seconde Guerre mondiale. Victoire sur les colonialistes français lors de la guerre d'indépendance de 1945-1954. créé des conditions favorables à l’unification pacifique du peuple vietnamien. Toutefois, cela ne s’est pas produit. La République Démocratique du Vietnam (DRV) a été créée dans la partie nord du Vietnam. Un gouvernement pro-américain fut formé au Sud-Vietnam qui, grâce à l’aide militaire et économique américaine, commença à créer en toute hâte sa propre armée. À la fin de 1958, il comptait 150 000 personnes et plus de 200 000 membres des forces paramilitaires. Utilisant ces forces, le régime sud-vietnamien a lancé des opérations punitives contre les forces patriotiques nationales du Sud-Vietnam. En réponse aux mesures répressives, le peuple vietnamien a lancé une guérilla active. Les combats ont couvert tout le territoire du pays. La DRV a fourni une assistance complète aux rebelles. Au milieu de 1964, les 2/3 du territoire du pays étaient déjà sous le contrôle des partisans.
Pour sauver son allié, le gouvernement américain a décidé de passer à une intervention militaire directe au Sud-Vietnam. Profitant de la collision de navires américains avec des torpilleurs de la République démocratique du Vietnam dans le golfe du Tonkin, les avions américains ont commencé le 5 août 1964 à bombarder systématiquement le territoire de la République démocratique du Vietnam. D'importants contingents de troupes américaines ont été déployés au Sud-Vietnam.
Le déroulement de la lutte armée au Vietnam peut être divisé en 3 périodes : la première (5 août 1964 - 1er novembre 1968) - la période d'escalade de l'intervention militaire américaine ; la seconde (novembre 1968 - 27 janvier 1973) - la période de réduction progressive de l'ampleur de la guerre ; troisième (28 janvier 1973 - 1er mai 1975) - la période des coups finaux des forces patriotiques et de la fin de la guerre.
Le plan du commandement américain prévoyait des frappes aériennes sur les objets les plus importants de la DRV et les communications des partisans sud-vietnamiens, les isolant ainsi de
assistance entrante, bloquer et détruire. Des unités d'infanterie américaine, des équipements et des armes les plus récents ont commencé à être transférés au Sud-Vietnam. Par la suite, le nombre de troupes américaines au Sud-Vietnam a constamment augmenté et s'élevait à : en 1965 - 155 000, en 1966 - 385 300 personnes, en 1967 - 485 800 personnes, en 1968 - 543 000 personnes.
En 1965-1966 Le commandement américain lance une offensive majeure dans le but de s'emparer de points importants du centre du Vietnam et de repousser les partisans dans les régions montagneuses, boisées et peu peuplées du pays. Cependant, ce plan fut contrecarré par les actions maniables et actives de l’Armée de Libération. La guerre aérienne contre la République démocratique du Vietnam s’est également soldée par un échec. Après avoir renforcé le système de défense aérienne avec des armes anti-aériennes (principalement des missiles guidés anti-aériens soviétiques), les artilleurs anti-aériens du DRV ont infligé des dégâts importants aux avions ennemis. En 4 ans, plus de 3 000 avions de combat américains ont été abattus au-dessus du territoire du Nord-Vietnam.
En 1968-1972 Les forces patriotiques ont mené trois offensives à grande échelle, au cours desquelles des zones comptant plus de 2,5 millions d'habitants ont été libérées. Saigon et les troupes américaines subissent de lourdes pertes et sont contraintes de se mettre sur la défensive.
En 1970-1971 Les flammes de la guerre se sont propagées aux États voisins du Vietnam – le Cambodge et le Laos. Le but de l’invasion des troupes américano-saïgonnaises était de couper la péninsule indochinoise en deux, d’isoler les patriotes sud-vietnamiens de la République démocratique du Vietnam et d’étrangler le mouvement de libération nationale dans cette région. Cependant, l’agression a échoué. Ayant rencontré une résistance décisive et subi de lourdes pertes, les interventionnistes ont retiré leurs troupes des territoires de ces deux États. Dans le même temps, le commandement américain entame un retrait progressif de ses troupes du Sud-Vietnam, transférant l'essentiel des combats vers les troupes du régime de Saigon.
Les actions réussies de la défense aérienne de la DRV et des partisans sud-vietnamiens, ainsi que les exigences de la communauté mondiale, ont contraint les États-Unis à signer le 27 janvier 1973 un accord mettant fin à la participation de leurs forces armées aux hostilités. La guerre du Vietnam. Au total, jusqu'à 2,6 millions de soldats et officiers américains ont pris part à cette guerre. Les troupes américaines étaient armées de plus de 5 000 avions et hélicoptères de combat, de 2 500 canons et de centaines de chars. Selon les données américaines, les États-Unis ont perdu environ 60 000 personnes tuées, plus de 300 000 personnes blessées, plus de 8 600 avions et hélicoptères et une grande quantité d'autres équipements militaires au Vietnam.
En 1975, les troupes et partisans du DRV achèvent la défaite de l'armée de Saigon et capturent le 1er mai Saigon, la capitale du Sud-Vietnam. Le régime fantoche est tombé. La lutte héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance, qui dure depuis 30 ans, s’est soldée par une victoire complète. En 1976, la République démocratique du Vietnam et la République du Sud-Vietnam ont formé un seul État : la République socialiste du Vietnam. Le principal résultat militaro-politique de la guerre fut de révéler une fois de plus l’impuissance de la puissance militaire la plus moderne face au peuple luttant pour sa libération nationale. Après leur défaite au Vietnam, les États-Unis ont perdu une grande partie de leur influence en Asie du Sud-Est.
Guerre indo-pakistanaise (1971)
La guerre indo-pakistanaise de 1971 était une conséquence du passé colonial des deux pays, qui faisaient partie de l'Inde britannique jusqu'en 1947, et le résultat de la division incorrecte du territoire de la colonie par les Britanniques après l'obtention de son indépendance.
Les principales causes de la guerre indo-pakistanaise de 1971 étaient :
les questions territoriales controversées non résolues, parmi lesquelles le problème du Jammu-et-Cachemire occupe une place clé ;
les contradictions politiques et économiques au sein du Pakistan, entre ses parties occidentale et orientale ;
le problème des réfugiés du Bengale oriental (9,5 millions de personnes au début de la guerre).
Au début de 1971, les forces armées indiennes comptaient environ 950 000 personnes. Elle était armée de plus de 1,1 mille chars, 5,6 mille canons et mortiers, plus de 900 avions et hélicoptères (environ 600 de combat), plus de 80 navires de guerre, bateaux et navires auxiliaires.
Les forces armées pakistanaises comptaient environ 370 000 personnes, plus de 900 chars, environ 3 300 canons et mortiers, 450 avions (350 de combat), 30 navires de guerre et navires auxiliaires.
Les forces armées indiennes étaient 2,6 fois plus nombreuses que les forces armées pakistanaises ; réservoirs - 1,3; canons et mortiers d'artillerie de campagne - 1,7 ; avions de combat - 1,7 ; navires de guerre et bateaux - 2,3 fois.
Les forces armées indiennes utilisaient principalement des équipements militaires modernes de fabrication soviétique, notamment des chars T-54, T-55, PT-76, des supports d'artillerie de 100 mm et 130 mm, des chasseurs MiG-21, des chasseurs-bombardiers Su-7b, des destroyers (grands navires anti-sous-marins), sous-marins et bateaux lance-missiles.
Les forces armées du Pakistan ont été construites avec l'aide des États-Unis (1954-1965), puis de la Chine, de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. L'instabilité de l'orientation de la politique étrangère en matière de développement militaire a affecté la composition et la qualité des armes. Seuls les chars T-59 de fabrication chinoise étaient comparables en capacités de combat aux chars indiens. Les autres types d'armes étaient pour la plupart inférieurs aux modèles indiens.
Le conflit indo-pakistanais peut être divisé en 2 périodes : la période menacée (avril-novembre 1971), les combats des parties (décembre 1971).
En décembre 1970, le parti de la Ligue Awami remporte les élections au Pakistan oriental (Bengale oriental). Cependant, le gouvernement pakistanais a refusé de lui céder le pouvoir et d'accorder l'autonomie interne au Pakistan oriental. Par ordre du président Yahya Khan du 26 mars 1971, l'activité politique dans le pays a été interdite, la Ligue Awami a été interdite et des troupes ont été envoyées au Pakistan oriental et ont commencé des opérations punitives contre la population. Le 14 avril 1971, les dirigeants de la Ligue Awami ont annoncé la création d'un gouvernement provisoire du Bangladesh et ont commencé les préparatifs de la lutte armée des forces rebelles de Mukti Bahini. Cependant, la résistance des groupes armés nationalistes du Bengale oriental a été brisée par les troupes pakistanaises fin mai et a rétabli le contrôle des grandes villes. Les répressions contre la population ont entraîné un exode massif des Bengalis vers l'Inde voisine, où à la mi-novembre 1971, le nombre de réfugiés s'élevait à 9,5 millions de personnes.
L'Inde a soutenu les rebelles bengalis en leur fournissant des armes et des bases sur son territoire. Après préparation, les détachements ont été transférés sur le territoire du Bengale oriental, où, au début de la guerre, leur nombre s'élevait à 100 000 personnes. Fin octobre, les troupes de Mukti Bahini, souvent avec le soutien direct des troupes indiennes, ont pris le contrôle de certaines zones le long de la frontière et au plus profond du Pakistan oriental, et le 21 novembre, les troupes régulières indiennes ont traversé la frontière et, avec les insurgés. , a commencé à se battre contre les troupes pakistanaises.
Le Pakistan, confronté à la menace du séparatisme du Bengale oriental, transféra au début de 1971 2 divisions supplémentaires au Pakistan oriental et commença la formation de nouvelles unités et détachements de protection civile dans cette province. Une mobilisation partielle a été annoncée et 40 000 réservistes ont été mobilisés. Les troupes se sont déplacées vers les frontières, formant 2 groupements - 13 divisions à la frontière occidentale avec l'Inde, 5 divisions à la frontière orientale. À la mi-novembre 1971, les forces armées furent pleinement prêtes au combat et le 23 novembre, l'état d'urgence fut déclaré dans le pays.
L'Inde a répondu en ramenant ses formations et ses unités aux niveaux de guerre en appelant des réservistes. Fin octobre, 2 groupes de troupes étaient déployés : l'ouest - 13 divisions et l'est - 7. Dans le même temps, l'Inde a accru son aide, y compris militaire, aux unités du mouvement de libération du Bengale oriental.
Le 3 décembre 1971, le gouvernement pakistanais, voyant une menace réelle de perdre la partie orientale du pays, déclare la guerre à l'Inde. A 17h45 heure locale, des avions pakistanais ont attaqué des bases aériennes indiennes. Les frappes n'ont pas produit les résultats escomptés : l'armée de l'air indienne a dispersé sa flotte aérienne et l'a camouflée à l'avance. Suite à cela, les troupes pakistanaises ont tenté de lancer une offensive sur le front occidental.
L'état d'urgence a été déclaré en Inde et les troupes ont reçu l'ordre de lancer des opérations militaires actives sur les fronts ouest et est, ainsi qu'en mer. Le matin du 4 décembre, l'offensive indienne débute au Bengale oriental. L'offensive a été organisée en direction de Dhaka depuis l'ouest, le nord-ouest et le nord-est (le territoire indien couvre le Bengale oriental sur trois côtés). Ici, l’Inde avait une double supériorité en termes de forces terrestres et une supériorité aérienne significative. Pendant 8 jours de combats, les troupes indiennes, en coopération avec les détachements de Mukti Bahini, ont brisé la résistance obstinée des Pakistanais et ont avancé de 65 à 90 km, créant une menace d'encerclement pour les troupes pakistanaises dans la région de Dhaka.
Sur le front occidental, les combats prennent un caractère positionnel. Ici, les partis avaient à peu près la même force. L'offensive des troupes pakistanaises, lancée le 3 décembre, n'a pas abouti et a été stoppée.
Le 11 décembre, le commandement indien a invité les troupes pakistanaises présentes sur le front oriental à se rendre. Ayant reçu un refus, les troupes indiennes ont poursuivi l'offensive et, le 14 décembre, ont finalement fermé l'anneau d'encerclement autour de Dhaka. Les unités indiennes sont entrées dans la ville le 16 décembre. Le même jour, l'acte de reddition d'un groupe de troupes pakistanaises au Bengale oriental a été signé. A l'ouest, un groupe de troupes pakistanaises a mis fin à ses opérations militaires avec l'accord des parties.
La marine indienne a joué un rôle important dans la victoire dans la guerre, chargée de mener des opérations offensives actives, de perturber les communications maritimes du Pakistan, de détruire les navires ennemis en mer et dans les bases et de frapper des cibles côtières. Pour résoudre ces problèmes, deux formations temporaires ont été constituées : « Western » (un croiseur, des patrouilleurs et 6 bateaux lance-missiles) pour les opérations dans la mer d'Oman et « East » (un porte-avions avec des navires d'escorte) pour les opérations dans le golfe du Bengale. . Les sous-marins (sous-marins) étaient chargés de bloquer les côtes pakistanaises de la mer d'Oman (2 sous-marins) et du golfe du Bengale (2 sous-marins).
Avec le déclenchement de la guerre, la marine indienne a bloqué les bases navales et les ports du Pakistan occidental et oriental. Le 4 décembre, une annonce officielle a été faite concernant un blocus naval de la côte pakistanaise. Les navires de la marine indienne déployés dans la mer d'Oman et dans le golfe du Bengale ont commencé à inspecter tous les navires voyageant à destination et en provenance des ports pakistanais.
Dans la nuit du 5 décembre, des navires indiens ont attaqué la principale base navale du Pakistan, Karachi. L'attaque a été menée par 3 bateaux lance-missiles de fabrication soviétique soutenant 2 navires de patrouille. À l'approche de la base, le bateau de tête a attaqué et détruit le destroyer pakistanais Khyber avec deux missiles. Le premier missile d'un autre bateau a touché un dragueur de mines
"Muhafiz", le deuxième missile était le destroyer "Badr" (tout l'état-major a été tué). Le transport stationné en rade a également été endommagé. En approchant de la base, les bateaux ont tiré deux autres missiles sur les installations portuaires et les patrouilleurs ont ouvert des tirs d'artillerie, endommageant le dragueur de mines pakistanais.
Ce succès de la marine indienne fut d'une grande importance pour la lutte en mer qui suivit. En mer d'Oman, le commandement pakistanais a renvoyé tous ses navires dans leurs bases, laissant ainsi à l'ennemi une liberté d'action.
D'autres navires de fabrication soviétique ont également montré d'excellentes performances lors des opérations navales. Ainsi, le 3 décembre, le destroyer indien Rajput a détruit le sous-marin pakistanais Ghazi à l'aide de grenades sous-marines dans le golfe du Bengale.
À la suite de deux semaines de combats, les forces armées indiennes ont vaincu les troupes pakistanaises, occupé le territoire du Bengale oriental et forcé la capitulation du groupe pakistanais qui leur était opposé. À l'ouest, les troupes indiennes ont occupé plusieurs sections du territoire pakistanais d'une superficie totale de 14 500 km2. La suprématie navale a été acquise et la navigation pakistanaise a été complètement bloquée.
Pertes pakistanaises : plus de 4 000 tués, environ 10 000 blessés, 93 000 prisonniers ; plus de 180 chars, environ 1 000 canons et mortiers, environ 100 avions. Le destroyer Khyber, le sous-marin Ghazi, le dragueur de mines Muhafiz, 3 patrouilleurs et plusieurs navires ont été coulés. Un certain nombre de navires de la marine pakistanaise ont été endommagés.
Pertes indiennes : environ 2,4 mille tués, plus de 6,2 mille blessés ; 73 chars, 220 canons et mortiers, 45 avions. La marine indienne a perdu le patrouilleur Kukri, 4 patrouilleurs et un avion anti-sous-marin. Le navire de patrouille et le bateau lance-missiles ont été endommagés.
Le Pakistan est sorti de la guerre affaibli politiquement, économiquement et militairement. La province orientale du pays a été perdue, sur le territoire de laquelle a été formé un État ami de l'Inde, la République populaire du Bangladesh. L'Inde a considérablement renforcé sa position en Asie du Sud. Dans le même temps, à la suite de la guerre, le problème du Cachemire et un certain nombre d'autres contradictions entre les pays n'ont pas été résolus, ce qui a prédéterminé la poursuite de la confrontation, de la course aux armements et de la rivalité nucléaire.
Guerres locales au Moyen-Orient
Après la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient est devenu l’une des régions les plus chaudes du monde. Les raisons de cet état résident dans les revendications territoriales mutuelles des États arabes et d’Israël. En 1948-1949 et 1956 (agression anglo-française-israélienne contre l'Égypte), ces contradictions ont abouti à des affrontements armés ouverts. Guerre israélo-arabe 1948-1949 a été combattu entre une coalition d’États arabes (Égypte, Syrie, Jordanie, Irak) et Israël. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer deux États indépendants en Palestine : un juif et un arabe. Israël a été créé le 14 mai 1948, mais l’État arabe de Palestine n’a pas été créé. Les dirigeants des États arabes n'étaient pas d'accord avec la décision de l'ONU de diviser la Palestine. Pour mener des opérations militaires, les États arabes ont créé un groupe comprenant au total 30 000 personnes, 50 avions, 50 chars, 147 canons et mortiers.
Les troupes israéliennes comptaient environ 40 000 personnes, 11 avions, plusieurs chars et véhicules blindés, environ 200 canons et mortiers.
L'offensive des troupes arabes a débuté le 15 mai en direction générale de Jérusalem dans le but de disséquer le groupe de troupes israéliennes et de le détruire pièce par pièce. À la suite de l’offensive du printemps et de l’été 1948, les troupes arabes atteignirent les abords de Jérusalem et de Tel-Aviv. En se retirant, les Israéliens ont épuisé les Arabes, en menant des défenses focalisées et manœuvrables et en agissant sur les communications. Le 11 juin, sur recommandation du Conseil de sécurité de l'ONU, une trêve est conclue entre les Arabes et Israël, mais elle s'avère fragile. À l'aube du 9 juillet, les troupes israéliennes ont lancé une offensive et ont infligé pendant 10 jours de lourdes pertes aux Arabes, les poussant hors de leurs positions et renforçant considérablement leur position. Le 18 juillet, la décision de cessez-le-feu de l'ONU est entrée en vigueur. Le plan de l'ONU visant à résoudre le conflit de manière pacifique a été rejeté par les deux parties belligérantes.
À la mi-octobre, Israël avait porté son armée à 120 000 personnes, 98 avions de combat et avait formé une brigade de chars. L'armée arabe comptait à cette époque 40 000 personnes et le nombre d'avions et de chars a diminué en raison des pertes au combat.
Israël, ayant une triple supériorité sur les troupes arabes en termes d'effectifs et une supériorité absolue en aviation et en chars, a violé la trêve et le 15 octobre 1948, ses troupes ont repris les hostilités. L'aviation israélienne a attaqué des aérodromes et détruit des avions arabes. En deux mois, au cours d’une série d’opérations offensives successives, les forces israéliennes ont encerclé et vaincu une partie importante des forces arabes et ont transféré les combats en Égypte et au Liban.
Sous la pression de la Grande-Bretagne, le gouvernement israélien a été contraint d'accepter une trêve. Le 7 janvier 1949, les hostilités cessent. En février-juillet 1949, avec la médiation de l'ONU, des accords furent conclus qui ne fixaient que des limites de cessez-le-feu temporaires.
Un nœud complexe de contradictions arabo-israéliennes s’est formé, qui est devenu la cause de toutes les guerres israélo-arabes ultérieures.
En octobre 1956, les états-majors de la Grande-Bretagne, de la France et d'Israël élaborèrent un plan d'action commune contre l'Égypte. Selon le plan, les troupes israéliennes, après avoir lancé des opérations militaires dans la péninsule du Sinaï, étaient censées vaincre l'armée égyptienne et atteindre le canal de Suez (opération Kadesh) ; Grande-Bretagne et France - bombardez les villes et les troupes égyptiennes, capturez Port-Saïd et Port-Fouad à l'aide de débarquements maritimes et aériens, puis débarquez les forces principales et occupez la zone du canal de Suez et du Caire (opération Mousquetaire). La taille du corps expéditionnaire anglo-français dépassait 100 000 personnes. L'armée israélienne était composée de 150 000 personnes, de 400 chars et canons automoteurs, d'environ 500 véhicules blindés de transport de troupes, de 600 canons et mortiers, de 150 avions de combat et de 30 navires de différentes classes. Au total, 229 000 personnes, 650 avions et plus de 130 navires de guerre, dont 6 porte-avions, étaient concentrés directement contre l'Égypte.
L'armée égyptienne comptait environ 90 000 personnes, 600 chars et canons automoteurs, 200 véhicules blindés de transport de troupes, plus de 600 canons et mortiers, 128 avions, 11 navires de guerre et plusieurs navires auxiliaires.
Dans la péninsule du Sinaï, les Israéliens étaient 1,5 fois plus nombreux que l'armée égyptienne, et dans certaines régions, plus de 3 fois ; le corps expéditionnaire avait une supériorité plus de cinq fois supérieure aux forces égyptiennes dans la région de Port-Saïd. Les opérations militaires ont commencé dans la soirée du 29 octobre par une attaque aéroportée israélienne.
Dans le même temps, les troupes israéliennes ont lancé une offensive dans les directions de Suez et ismaélienne et, le 31 octobre, dans la direction côtière. La flotte anglo-française établit un blocus naval de l'Égypte.
En direction de Suez, les troupes israéliennes ont atteint les abords du canal le 1er novembre. En direction ismaélienne, les troupes égyptiennes abandonnent la ville d'Abu Aweigil. Dans le sens côtier, les combats se sont poursuivis jusqu'au 5 novembre.
Le 30 octobre, les gouvernements britannique et français lancent un ultimatum aux Égyptiens. Suite au refus du gouvernement égyptien d'accepter l'ultimatum, des cibles militaires et civiles ont été soumises à de violents bombardements. Des assauts amphibies ont été débarqués. Il y avait une menace de capture de la capitale égyptienne.
La session d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est ouverte le 1er novembre, a exigé de manière décisive un cessez-le-feu de la part des parties belligérantes. L'Angleterre, la France et Israël ont refusé de se conformer à cette demande. Le 5 novembre, l'Union soviétique a mis en garde contre sa détermination
recourir à la force militaire pour rétablir la paix au Moyen-Orient. Le 7 novembre, les hostilités cessent. Le 22 décembre 1956, la Grande-Bretagne et la France, et le 8 mars 1957, Israël retirèrent leurs troupes des territoires occupés. Le canal de Suez, fermé à la navigation depuis le début des hostilités, est mis en service fin avril 1957.
En juin 1967, Israël lance une nouvelle guerre contre les États arabes. Le plan du commandement militaire israélien prévoyait une défaite fulgurante un par un des États arabes voisins, avec une attaque principale contre l'Égypte. Dans la matinée du 5 juin, des avions israéliens ont mené des attaques surprises sur des aérodromes en Égypte, en Syrie et en Jordanie. En conséquence, 65 % des forces aériennes de ces pays ont été détruites et la suprématie aérienne a été acquise.
L'offensive israélienne sur le front égyptien s'est déroulée dans trois directions principales. Le 6 juin, après avoir brisé la résistance des Egyptiens et contrecarré les contre-attaques entreprises par le commandement égyptien, les troupes israéliennes entamèrent leur poursuite. La majeure partie des formations égyptiennes situées sur la péninsule du Sinaï ont été coupées. Le 8 juin à midi, les unités avancées israéliennes atteignirent le canal de Suez. À la fin de la journée, les hostilités actives dans la péninsule du Sinaï avaient cessé.
Sur le front jordanien, l’offensive israélienne débute le 6 juin. Dès les premières heures, les brigades israéliennes ont percé les défenses jordaniennes et ont étendu leur succès en profondeur. Le 7 juin, ils ont encerclé et vaincu le groupe principal des troupes jordaniennes et, à la fin du 8 juin, ils ont atteint la rivière sur tout le front. Jordan.
Le 9 juin, Israël a attaqué la Syrie de toutes ses forces. Le coup principal a été porté au nord du lac de Tibériade au cours des années. El Quneitra et Damas. Les troupes syriennes ont opposé une résistance acharnée, mais en fin de compte, elles n'ont pas pu résister à l'assaut et, malgré leur supériorité en forces et en moyens, ont commencé à battre en retraite. En fin de journée du 10 juin, les Israéliens s’étaient emparés du plateau du Golan, coincé dans le territoire syrien jusqu’à 26 km de profondeur. Ce n'est que grâce à la position décisive et aux mesures énergiques prises par l'Union soviétique que les pays arabes ont évité une défaite totale.
Au cours des années suivantes, le refus d'Israël de libérer les territoires arabes capturés a obligé l'Égypte et la Syrie à y parvenir par des moyens armés. Les combats ont commencé simultanément sur les deux fronts au milieu de la journée du 6 octobre 1973. Au cours de combats acharnés, les troupes syriennes ont chassé l'ennemi de ses positions et ont avancé de 12 à 18 km. En fin de journée du 7 octobre, l'offensive est suspendue en raison de pertes importantes. Dans la matinée du 8 octobre, le commandement israélien, mobilisant ses réserves des profondeurs, lance une contre-attaque. Sous la pression de l'ennemi, le 16 octobre, les Syriens furent contraints de se replier sur leur deuxième ligne de défense, où le front se stabilisa.
À leur tour, les troupes égyptiennes ont réussi à traverser le canal de Suez, à capturer la 1ère ligne de défense ennemie et à créer des têtes de pont jusqu'à 15 à 25 km de profondeur. Cependant, en raison de la passivité du commandement égyptien, le succès de l'offensive n'a pas été développé. Le 15 octobre, les Israéliens lancent une contre-attaque, traversent le canal de Suez et s'emparent d'une tête de pont sur sa rive ouest. Dans les jours suivants, développant une offensive basée sur les partisans, ils bloquèrent Suez, Ismaïlia et créèrent une menace d'encerclement de la 3e armée égyptienne. Dans cette situation, l’Égypte s’est tournée vers l’URSS pour lui demander de l’aide. Grâce à la position dure adoptée par l'Union soviétique à l'ONU, les hostilités furent arrêtées le 25 octobre 1973.
Même si l’Égypte et la Syrie n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, les résultats de la guerre ont été positifs pour eux. Tout d’abord, dans l’esprit des Arabes, une sorte de barrière psychologique née de la défaite de la guerre de 1967 a été surmontée. Les armées arabes ont dissipé le mythe de l’invincibilité israélienne, démontrant qu’elles étaient tout à fait capables de combattre les troupes israéliennes. .
La guerre de 1973 fut la plus grande guerre locale au Moyen-Orient. Des deux côtés, jusqu'à 1 million 700 000 personnes, 6 000 chars et 1 800 avions de combat y ont participé. Les pertes des pays arabes se sont élevées à plus de 19 000 personnes, jusqu'à 2 000 chars et environ 350 avions. Israël a perdu plus de 15 000 personnes, 700 chars et jusqu'à 250 avions dans cette guerre. La particularité de cette guerre était qu'elle était menée par des forces armées régulières, équipées de tous types d'équipements et d'armes militaires modernes.
En juin 1982, le Moyen-Orient était à nouveau plongé dans les flammes de la guerre. Cette fois, le théâtre des hostilités était le Liban, sur le territoire duquel se trouvaient des camps de réfugiés palestiniens. Les Palestiniens ont mené des raids sur le territoire israélien, tentant ainsi de forcer le gouvernement israélien à négocier la restitution des territoires conquis en 1967. D'importantes forces de troupes israéliennes ont été introduites sur le territoire libanais et sont entrées à Beyrouth. De violents combats se sont poursuivis pendant plus de trois mois. Malgré le retrait des troupes palestiniennes de Beyrouth-Ouest et la solution partielle des tâches assignées, les troupes israéliennes sont restées au Liban pendant les huit années suivantes.
En 2000, les troupes israéliennes se sont retirées du sud du Liban. Toutefois, cette étape n’a pas apporté la paix tant attendue. Les exigences du public arabe concernant la création de son propre État sur les terres occupées par Israël n’ont pas trouvé de compréhension à Tel-Aviv. À leur tour, les nombreuses attaques terroristes commises par des kamikazes arabes contre des Juifs n’ont fait que resserrer davantage le nœud des contradictions et ont contraint l’armée israélienne à réagir par des mesures de force sévères. À l’heure actuelle, les contradictions israélo-arabes non résolues pourraient à tout moment faire exploser la paix fragile de cette région troublée. C’est pourquoi la Russie, les États-Unis, l’ONU et l’Union européenne (les « Quatre du Moyen-Orient ») font tout leur possible pour mettre en œuvre le plan de règlement au Moyen-Orient qu’ils ont élaboré en 2003, appelé « Feuille de route ».
Guerre en Afghanistan (1979-1989)
DANS Fin décembre 1979, le gouvernement afghan s'est à nouveau tourné vers l'URSS pour lui demander de fournir une assistance militaire pour repousser une agression extérieure. Les dirigeants soviétiques, fidèles à leurs obligations conventionnelles et afin de protéger les frontières sud du pays, ont décidé d'envoyer un contingent limité de troupes soviétiques (LCSV) en République démocratique d'Afghanistan (DRA). On a calculé qu'avec l'introduction de formations de l'armée soviétique dans la DRA, la situation se stabiliserait. La participation des troupes aux hostilités n'était pas envisagée.
La présence de l'OKSV en Afghanistan, selon la nature des actions, peut être divisée en 4 périodes : 1ère période (décembre 1979 - février 1980) - déploiement des troupes, placement en garnisons, organisation de la protection des points de déploiement et des installations critiques ; 2e période (mars 1980 - avril 1985) - conduite d'opérations de combat actives contre les forces de l'opposition, travaux de renforcement des forces armées afghanes ; 3ème période (avril 1985 - janvier 1987) - transition des hostilités actives principalement vers le soutien des troupes gouvernementales, combattant les caravanes rebelles à la frontière ; 4e période (janvier 1987 - février 1989) - maintien du soutien aux activités de combat des troupes gouvernementales, préparation et retrait de l'OKSV d'Afghanistan.
Le calcul des dirigeants politiques de l'URSS et de la DRA selon lequel la situation se stabiliserait avec l'introduction de troupes ne s'est pas réalisé. L’opposition, utilisant le slogan du « jihad » (lutte sacrée contre les infidèles), a intensifié son activité armée. Répondant aux provocations et se défendant, nos unités furent de plus en plus entraînées dans la guerre civile. Les combats ont eu lieu dans tout l'Afghanistan.
Les premières tentatives du commandement soviétique pour mener des opérations offensives selon les règles de la guerre classique n'ont pas abouti. Les opérations de raid dans le cadre de bataillons renforcés se sont également révélées inefficaces. Les troupes soviétiques subissent de lourdes pertes et les Moudjahidines, qui connaissent bien le terrain, échappent à l'attaque par petits groupes et se détachent de leur poursuite.
Les formations d'opposition combattaient généralement en petits groupes de 20 à 50 personnes. Pour résoudre des problèmes plus complexes, les groupes se sont regroupés en détachements de 150 à 200 personnes ou plus. Parfois, des « régiments islamiques » comptant entre 500 et 900 personnes ou plus étaient formés. La base de la lutte armée était les formes et les méthodes de la guérilla.
Depuis 1981, le commandement de l'OKSV s'est tourné vers la conduite d'opérations avec des forces importantes, qui se sont révélées beaucoup plus efficaces (opération « Ring » à Parwan, opération offensive et raids au Panjshir). L'ennemi a subi des pertes importantes, mais il n'a pas été possible de vaincre complètement les détachements de moudjahidines.
Le plus grand nombre d'OKSV (1985) était de 108,8 mille personnes (personnel militaire - 106 mille), dont 73,6 mille personnes dans les unités de combat des forces terrestres et aériennes. Le nombre total de l'opposition armée afghane au cours des différentes années variait entre 47 000 et 173 000 personnes.
Au cours des opérations dans les zones occupées par les troupes, des autorités étatiques ont été créées. Cependant, ils n’avaient aucun pouvoir réel. Après que les troupes gouvernementales soviétiques ou afghanes eurent quitté la zone occupée, leur place fut à nouveau prise par les rebelles survivants. Ils ont détruit les militants du parti et restauré leur influence dans la région. Par exemple, dans la vallée du Panjshir, 12 opérations militaires ont été menées en 9 ans, mais le pouvoir du gouvernement dans cette région n'a jamais été consolidé.
En conséquence, à la fin de 1986, un équilibre était apparu : les troupes gouvernementales, même celles soutenues par l'OKSV, ne pouvaient pas infliger une défaite décisive à l'ennemi et le forcer à arrêter la lutte armée, et l'opposition, à son tour, était incapable de renverser par la force le régime en place dans le pays. Il est devenu évident que le problème afghan ne pourrait être résolu que par la négociation.
En 1987, la direction de la DRA a proposé à l'opposition une politique de réconciliation nationale. Au début, ce fut un succès. Des milliers de rebelles ont arrêté les combats. Les principaux efforts de nos troupes au cours de cette période ont été consacrés à la protection et à la livraison des ressources matérielles provenant de l'Union soviétique. Mais l'opposition, sentant un grave danger pour elle-même dans la politique de réconciliation nationale, a intensifié ses activités subversives. De violents combats reprennent. Cela a été largement facilité par la fourniture des armes les plus récentes en provenance de l’étranger, notamment les systèmes de missiles anti-aériens portables américains Stinger.
Dans le même temps, la politique déclarée a ouvert des perspectives de négociations pour résoudre la question afghane. Le 14 avril 1988, des accords ont été signés à Genève pour mettre fin à l'ingérence extérieure en Afghanistan.
Les accords de Genève ont été pleinement mis en œuvre par la partie soviétique : le 15 août 1988, les effectifs de l'OKSV étaient réduits de 50 % et le 15 février 1989, la dernière unité soviétique quittait le territoire afghan.
Le retrait des troupes soviétiques s'est effectué sur une base planifiée. Dans la direction ouest, les troupes ont été retirées le long de la route Kandahar, Farakhrud, Shindand, Turagundi, Kushka et dans la direction est - le long de cinq routes, en commençant par les garnisons de Jalalabad, Ghazni, Faizabad, Kunduz et Kaboul, puis par Puli- Khumri à Hairatan et Termez. Une partie du personnel des aérodromes de Jalala-bad, Gardez, Fayzabad, Kunduz, Kandahar et Shindand a été transportée par avion.
Trois jours avant le début du mouvement des colonnes, toutes les routes étaient bloquées, les avant-postes étaient renforcés, l'artillerie était amenée en position de tir et prête à tirer. Feu-
L'impact militaire sur l'ennemi a commencé 2 à 3 jours avant le début de l'avancée. L'aviation opérait en étroite coopération avec l'artillerie, qui assurait le retrait des troupes d'une position de service dans les airs. Des tâches importantes lors du retrait des troupes soviétiques ont été accomplies par des unités et sous-unités du génie, déterminées par la situation difficile des mines sur les itinéraires de mouvement.
Les formations et unités de l'OKSV en Afghanistan ont constitué la force décisive qui a assuré le maintien du pouvoir entre les mains des organes gouvernementaux et des dirigeants de la DRA. Ils sont en 1981-1988. mené presque continuellement des hostilités actives.
Pour le courage et le courage manifestés sur le sol afghan, 86 personnes ont reçu le titre de Héros de l'Union soviétique. Plus de 200 000 soldats et officiers ont reçu des ordres et des médailles. La plupart d’entre eux sont des garçons âgés de 18 à 20 ans.
Les pertes humaines totales irréparables des forces armées soviétiques se sont élevées à 14 453 personnes. Dans le même temps, les organes de contrôle, formations et unités de l'OKSV ont perdu 13 833 personnes. En Afghanistan, 417 militaires ont été portés disparus ou capturés, dont 119 ont été libérés.
Les pertes sanitaires se sont élevées à 469.685 personnes, dont : 53.753 personnes blessées, choquées et blessées (11,44%) ; malade - 415 932 personnes (88,56%).
Les pertes d'équipements et d'armes s'élevaient à : avions - 118 ; hélicoptères - 333 ; chars - 147; BMP, BMD et véhicules blindés de transport de troupes - 1314 ; canons et mortiers - 433 ; stations de radio et KShM - 1138 ; véhicules d'ingénierie - 510 ; véhicules à plateau et camions-citernes - 11 369.
Comme principales conclusions de l'expérience des activités de combat de l'OKSV en Afghanistan, il convient de noter ce qui suit :
1. Le groupe de troupes soviétiques introduit sur le territoire afghan à la fin de 1979 et au début de 1980 s'est trouvé dans des conditions très particulières. Cela a nécessité des changements majeurs dans les structures organisationnelles et l'équipement standard des formations et unités, dans la formation du personnel et dans les activités quotidiennes et de combat de l'OKSV.
2. Les spécificités de la présence militaire soviétique en Afghanistan ont déterminé la nécessité de développer et de maîtriser des formes, des méthodes et des techniques d'opérations de combat atypiques pour la théorie et la pratique militaires nationales. Les questions de coordination des actions des troupes soviétiques et gouvernementales afghanes sont restées problématiques tout au long de leur séjour en Afghanistan. L'Afghanistan a accumulé une riche expérience dans l'utilisation de diverses branches des forces terrestres et aériennes dans des conditions physiques, géographiques et climatiques difficiles.
3. Pendant la période de présence militaire soviétique en Afghanistan, une expérience unique a été acquise dans l'organisation des systèmes de communication, la guerre électronique, la collecte, le traitement et la mise en œuvre en temps opportun des informations de renseignement, la mise en œuvre de mesures de camouflage, ainsi que l'ingénierie, la logistique, les techniques et médicales. soutien aux activités de combat de l'OKSV. En outre, l'expérience afghane offre
4. Il existe de nombreux exemples d'informations efficaces et d'influence psychologique sur l'ennemi tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.
5. Après le retrait de l'OKSV, les combats entre les troupes gouvernementales et les détachements de moudjahidines se sont poursuivis jusqu'en 1992, lorsque les partis d'opposition sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Cependant, la paix n’est jamais revenue dans ce pays déchiré par la guerre. Une lutte armée pour le pouvoir et les sphères d'influence éclate alors entre les partis et les dirigeants de l'opposition, à la suite de laquelle le mouvement taliban accède au pouvoir. Après l’attentat terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis et l’opération antiterroriste internationale qui a suivi en Afghanistan, les talibans ont été chassés du pouvoir, mais la paix n’est jamais revenue sur le territoire afghan.
Guerre Iran-Irak (1980-1988)
Il s’agit de la guerre la plus sanglante et la plus destructrice du dernier quart du XXe siècle. a eu un impact direct non seulement sur les pays et les peuples voisins, mais aussi sur la situation internationale dans son ensemble.
Les principales causes du conflit étaient les positions inconciliables des parties sur les questions territoriales, le désir de leadership dans la région du golfe Persique, les contradictions religieuses et l'antagonisme personnel entre elles. Le président irakien Saddam Hussein et le dirigeant iranien l'ayatollah Khomeini, les déclarations provocatrices dans les médias occidentaux sur l'effondrement de la machine militaire iranienne après la Révolution islamique (1979), ainsi que les politiques incendiaires des États-Unis et d'Israël, qui cherchaient à utiliser le approfondissant la confrontation Iran-Irak dans leurs intérêts stratégiques au Moyen-Orient et au Moyen-Orient.
Le groupement des forces terrestres des parties au début de la guerre dans la zone frontalière était composé de : Irak - 140 000 personnes, 1 300 chars, 1 700 canons d'artillerie de campagne et mortiers ; Iran - 70 000 personnes, 620 chars, 710 canons et mortiers.
La supériorité de l'Irak en forces terrestres et en chars était 2 fois plus grande, et en canons et mortiers - 2,4 fois.
À la veille de la guerre, l’Iran et l’Irak disposaient d’un nombre à peu près égal d’avions de combat (respectivement 316 et 322). Dans le même temps, les parties étaient armées, à de rares exceptions près, soit uniquement d'avions américains (Iran), soit soviétiques, qui depuis les années 1950. est devenue l’un des traits caractéristiques de la plupart des guerres et conflits armés locaux.
Cependant, l'armée de l'air irakienne était nettement supérieure à l'armée de l'air iranienne, tant en nombre d'avions prêts au combat pilotés par l'équipage de conduite qu'en termes de logistique du matériel aéronautique et de capacité de réapprovisionnement en munitions et en pièces de rechange. Le rôle principal a été joué par la coopération continue de l'Irak avec l'URSS et les pays arabes, dont les forces aériennes utilisaient les mêmes types d'avions de fabrication soviétique.
L'état de préparation au combat de l'armée de l'air iranienne a été affecté, d'une part, par la rupture des liens militaires traditionnels avec les États-Unis après la Révolution islamique, et d'autre part, par la répression exercée par les nouvelles autorités contre les niveaux supérieurs et intermédiaires du commandement de l'armée de l'air. personnel. Tout cela a conduit à la supériorité aérienne de l'Irak pendant la guerre.
Les marines des deux pays disposaient d'un nombre égal de navires de guerre et de bateaux - 52 chacun. Cependant, la marine iranienne dépassait largement la marine irakienne en termes de nombre de navires de guerre des principales classes, d'armement et de niveau de préparation au combat. La marine irakienne manquait d'aviation navale et de marines, et la force de frappe ne comprenait qu'une force de bateaux lance-missiles.
Ainsi, au début de la guerre, l'Irak disposait d'une supériorité écrasante en matière de forces terrestres et aériennes ; l'Iran n'a réussi à conserver un avantage sur l'Irak que dans le domaine des armes navales.
Le début de la guerre a été précédé par une période de relations aggravées entre les deux États. Le 7 avril 1980, le ministère iranien des Affaires étrangères annonçait le retrait du personnel de son ambassade et de son consulat de Bagdad et invitait l'Irak à faire de même. Du 4 au 10 septembre, les troupes irakiennes ont occupé les zones frontalières contestées du territoire iranien et le 18 septembre, le Conseil national irakien a décidé de dénoncer le traité Iran-Irak du 13 juin 1975. L'Iran a fermement condamné cette décision, affirmant qu'elle respecter les dispositions du traité.
Les combats pendant la guerre Iran-Irak peuvent être divisés en 3 périodes : 1ère période (septembre 1980-juin 1982) - l'offensive réussie des troupes irakiennes, la contre-offensive des formations iraniennes et le retrait des troupes irakiennes vers leurs positions d'origine ; 2e période (juillet 1982 - février 1984) - opérations offensives des troupes iraniennes et défense manœuvrable des formations irakiennes ; 3ème période (mars 1984 - août 1988) - une combinaison d'opérations interarmes et de combats de forces terrestres avec des opérations de combat en mer et des frappes de missiles et aériennes contre des cibles situées profondément à l'arrière des parties.
1ère période. Le 22 septembre 1980, les troupes irakiennes franchissent la frontière et lancent des opérations offensives contre l'Iran sur un front situé à 650 km de Qasre Shirin au nord jusqu'à Khorramshahr au sud. En un mois de combats acharnés, ils ont réussi à avancer jusqu'à une profondeur de 20 à 80 km, à capturer un certain nombre de villes et à s'emparer de plus de 20 000 km2 de territoire iranien.
Les dirigeants irakiens poursuivaient plusieurs objectifs : la capture de la province pétrolière du Khouzistan, où prédominait la population arabe ; révision des accords bilatéraux sur les questions territoriales en leur faveur ; retirer l’ayatollah Khomeini du pouvoir et le remplacer par une autre personnalité laïque libérale.
Au début de la guerre, les opérations militaires se sont déroulées favorablement en Irak. La supériorité établie des forces terrestres et aériennes, ainsi que la surprise de l'attaque, ont eu un effet, puisque les services de renseignement iraniens ont été gravement endommagés par les purges post-révolutionnaires et ont été incapables d'organiser la collecte d'informations sur le moment de l'attaque. , le nombre et le déploiement des troupes irakiennes.
Les combats les plus intenses ont éclaté au Khouzistan. En novembre, après plusieurs semaines de combats sanglants, le port iranien de Khorramshahr est capturé. À la suite des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie, de nombreuses raffineries et champs de pétrole iraniens ont été complètement désactivés ou endommagés.
La poursuite de l'avancée des troupes irakiennes à la fin des années 1980 a été stoppée par les formations iraniennes avancées depuis les profondeurs du pays, ce qui a égalisé les forces des belligérants et donné aux combats un caractère de position. Cela a permis à l'Iran, au printemps et à l'été 1981, de réorganiser ses troupes et d'augmenter leurs effectifs, et à l'automne de passer à l'organisation d'opérations offensives sur des secteurs individuels du front. A partir de septembre
De 1981 à février 1982, plusieurs opérations ont été menées pour débloquer et libérer les villes conquises par les Irakiens. au printemps
En 1982, des opérations offensives à grande échelle ont été menées dans le sud de l’Iran, au cours desquelles la tactique des « vagues humaines » a été utilisée, entraînant d’énormes pertes parmi les assaillants.
Les dirigeants irakiens, ayant perdu l'initiative stratégique et n'ayant pas réussi à résoudre les tâches assignées, ont décidé de retirer leurs troupes jusqu'à la frontière nationale, ne laissant derrière eux que les territoires contestés. Fin juin 1982, le retrait des troupes irakiennes était en grande partie achevé. Bagdad a tenté de persuader Téhéran de négocier la paix, proposition qui a toutefois été rejetée par les dirigeants iraniens.
2ème période. Le commandement iranien a commencé à mener des opérations offensives à grande échelle dans le secteur sud du front, où quatre opérations ont été menées. Des attaques auxiliaires durant cette période ont été menées sur les secteurs centre et nord du front.
En règle générale, les opérations commençaient dans l'obscurité, se caractérisaient par d'énormes pertes de main-d'œuvre et se terminaient soit par des succès tactiques mineurs, soit par le retrait des troupes vers leurs positions d'origine. Les troupes irakiennes ont également subi de lourdes pertes, menant une manœuvre de défense active, utilisant des retraits planifiés de troupes, des contre-attaques et des contre-attaques de formations blindées et d'unités bénéficiant d'un appui aérien. En conséquence, la guerre s’est retrouvée dans une impasse positionnelle et a pris de plus en plus le caractère d’une « guerre d’usure ».
La 3ème période a été caractérisée par une combinaison d'opérations interarmes et de batailles de forces terrestres avec des opérations de combat en mer, qui ont reçu le nom de « guerre des pétroliers » dans l'historiographie étrangère et nationale, ainsi que par des frappes de missiles et aériennes sur des villes et des zones économiques importantes. objets à l’arrière profond (« villes de guerre »).
L’initiative de mener des opérations militaires, à l’exclusion du déploiement d’une « guerre des pétroliers », est restée entre les mains du commandement iranien. De l’automne 1984 à septembre 1986, il mène quatre opérations offensives d’envergure. Elles n’ont pas produit de résultats significatifs, mais, comme auparavant, elles ont été extrêmement sanglantes.
Dans le but de mettre fin victorieusement à la guerre, les dirigeants iraniens ont annoncé une mobilisation générale, grâce à laquelle il a été possible de compenser les pertes et de renforcer les troupes opérant au front. De fin décembre 1986 à mai 1987, le commandement des forces armées iraniennes a mené systématiquement dix opérations offensives. La plupart d'entre eux ont eu lieu dans le secteur sud du front, les résultats ont été insignifiants et les pertes ont été énormes.
La nature prolongée de la guerre Iran-Irak a permis de parler d’une guerre « oubliée », mais seulement tant que la lutte armée s’est déroulée principalement sur le front terrestre. L'extension de la guerre maritime au printemps 1984 de la zone de la partie nord du golfe Persique à l'ensemble du Golfe, son intensité et son orientation croissantes contre la navigation internationale et les intérêts des pays tiers, ainsi que la menace créé par les communications stratégiques passant par le détroit d'Ormuz, non seulement l'a fait sortir du champ de la « guerre oubliée », mais a également conduit à l'internationalisation du conflit, au déploiement et à l'utilisation de groupes navals d'États non côtiers dans la zone du golfe Persique. .
Le début de la « guerre des pétroliers » est considéré comme le 25 avril 1984, lorsque le superpétrolier saoudien Safina al-Arab, d'un déplacement de 357 000 tonnes, a été touché par un missile irakien Exocet AM-39. Un incendie s'est déclaré sur le navire, jusqu'à 10 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer et les dégâts se sont élevés à 20 millions de dollars.
L'ampleur et l'importance de la « guerre des pétroliers » sont caractérisées par le fait qu'au cours des 8 années de la guerre Iran-Irak, 546 grands navires de la flotte marchande ont été attaqués et que le déplacement total des navires endommagés a dépassé 30 millions de tonnes. Les cibles prioritaires des attaques étaient les pétroliers : 76 % des navires attaqués, d'où le nom de « guerre des pétroliers ». Dans le même temps, les navires de guerre utilisaient principalement des armes à missiles, ainsi que de l'artillerie ; l'aviation a utilisé des missiles antinavires et des bombes aériennes. Selon Lloyd's Insurance, 420 marins civils sont morts à la suite des hostilités en mer, dont 94 en 1988.
Affrontement militaire dans la zone du golfe Persique en 1987-1988. Outre le conflit Iran-Irak, il s’est développé principalement dans le sens d’une aggravation des relations américano-iraniennes. Une manifestation de cette confrontation a été la lutte sur les communications maritimes (« guerre des pétroliers »), dans laquelle les forces des États-Unis et de l'Iran ont agi avec des objectifs directement opposés - respectivement, protéger et perturber le transport maritime. Durant ces années, ils participèrent à la protection de la navigation dans le golfe Persique.
ainsi que les marines de cinq pays européens membres de l'OTAN : la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique.
Les bombardements et les inspections de navires battant pavillon soviétique conduisent à l'envoi d'un détachement de navires de guerre (4 navires) de l'escouade déployée au début des années 1970 dans le golfe Persique. dans l'océan Indien du 8e escadron opérationnel de la marine de l'URSS, subordonné au commandement de la flotte du Pacifique.
Depuis septembre 1986, les navires de l'escadron ont commencé à escorter des navires soviétiques et certains navires affrétés dans la baie.
De 1987 à 1988, les navires de l'escadron ont conduit 374 navires marchands dans les golfes Persique et d'Oman dans 178 convois sans perte ni dommage.
À l’été 1988, les participants à la guerre se trouvaient finalement dans une impasse politique, économique et militaire et furent contraints de s’asseoir à la table des négociations. Le 20 août 1988, les hostilités cessent. La guerre n'a pas révélé de vainqueur. Les partis ont perdu plus de 1,5 million de personnes. Les pertes matérielles se chiffrent en centaines de milliards de dollars.
Guerre du Golfe (1991)
Dans la nuit du 2 août 1990, les troupes irakiennes envahissent le Koweït. Les principales raisons étaient des revendications territoriales de longue date, des accusations de production pétrolière illégale et une baisse des prix du pétrole sur le marché mondial. En un jour, les troupes de l'agresseur ont vaincu la petite armée koweïtienne et occupé le pays. Les exigences du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le retrait immédiat des troupes du Koweït ont été rejetées par l'Irak.
Le 6 août 1990, le gouvernement américain a décidé de déployer stratégiquement un contingent de ses forces armées dans la région du golfe Persique. Dans le même temps, les États-Unis ont commencé à former une coalition anti-irakienne et à créer une Force multinationale (FMN).
Le plan élaboré par le commandement américain prévoyait deux opérations : « Desert Shield » - le transfert avancé des troupes inter-théâtres et la création d'une force de frappe dans la zone de crise et « Desert Storm » - la conduite d'opérations de combat directes pour vaincre les forces armées irakiennes.
Au cours de l’opération Desert Shield, des centaines de milliers de personnes et d’énormes quantités de matériel ont été transférées vers la région du golfe Persique par voie aérienne et maritime pendant 5,5 mois. À la mi-janvier 1991, la concentration du groupe MNF prend fin. Il se composait de : 16 corps (jusqu'à 800 000 personnes), environ 5,5 mille chars, 4,2 mille canons et mortiers, environ 2,5 mille avions de combat, environ 1,7 mille hélicoptères, 175 navires de guerre. Jusqu’à 80 % de ces forces et moyens étaient des troupes américaines.
Les dirigeants politiques et militaires de l'Irak, à leur tour, ont pris un certain nombre de mesures pour accroître les capacités de combat de leurs troupes. Leur essence était de créer dans le sud du pays et au Koweït
puissant groupe défensif, pour lequel d'importantes masses de troupes ont été transférées des régions occidentales et centrales de l'Irak. En outre, de nombreux travaux ont été menés sur les équipements d'ingénierie destinés à la zone des opérations de combat à venir, le camouflage d'objets, la construction de lignes de défense et la création de fausses zones de déploiement de troupes. Au 16 janvier 1991, le groupe sud des forces armées irakiennes comprenait : plus de 40 divisions (plus de 500 000 personnes), environ 4,2 mille chars, 5,3 mille canons, des systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) et des mortiers. Ses actions étaient censées soutenir plus de 760 avions de combat, jusqu'à 150 hélicoptères et tout l'état-major disponible de la marine irakienne (13 navires et 45 bateaux).
L'opération Desert Storm, en tant que deuxième partie du plan global, s'est déroulée du 17 janvier au 28 février 1991. Elle comprenait 2 étapes : la première - une opération offensive aérienne (17 janvier - 23 février) ; la seconde est une opération offensive du groupe terrestre des forces de la FMN (24-28 février).
Les opérations de combat ont commencé le 17 janvier avec des attaques de missiles de croisière Tomahawk contre les installations du système de contrôle, les aérodromes et les positions de défense aérienne des forces armées irakiennes. Les raids ultérieurs de l'aviation de la FMN ont détruit les installations à potentiel militaro-économique de l'ennemi et les centres de communication les plus importants du pays, et ont détruit les armes de missiles. Des frappes ont également été menées contre les positions du premier échelon et les réserves les plus proches de l'armée irakienne. Après plusieurs jours de bombardements, les capacités de combat et le moral des troupes irakiennes ont fortement diminué.
Au même moment, les préparatifs étaient en cours pour une opération offensive des forces terrestres, baptisée « Desert Sword ». Son plan était de porter le coup principal au centre avec les forces du 7e corps d'armée et du 18e corps aéroporté (USA), pour encercler et couper le groupe sud des troupes irakiennes au Koweït. Des attaques auxiliaires ont été menées dans la direction côtière et sur l'aile gauche du front dans le but de capturer la capitale du Koweït afin de protéger les forces principales d'une attaque sur le flanc.
L'offensive du groupe terrestre de la FMN a débuté le 24 février. Les actions des forces de la coalition ont été couronnées de succès sur tout le front. Dans la direction côtière, les formations du Corps des Marines des États-Unis, en coopération avec les troupes arabes, ont pénétré les défenses ennemies jusqu'à une profondeur de 40 à 50 km et ont créé une menace d'encerclement du groupe irakien défendant dans la partie sud-est du Koweït. Dans la direction centrale, les formations du 7e corps d'armée (USA), sans rencontrer de résistance sérieuse, ont avancé de 30 à 40 km. Sur le flanc gauche, la 6e division blindée (France) s'empare rapidement de l'aérodrome d'Es-Salman, capturant jusqu'à 2,5 mille soldats et officiers ennemis.
Les actions défensives dispersées des troupes irakiennes étaient de nature focale. Les tentatives du commandement irakien de mener des contre-attaques et des contre-attaques ont été contrecarrées par les avions de la FMN. Après avoir subi des pertes importantes, les formations irakiennes ont commencé à battre en retraite.
Dans les jours suivants, la FMN poursuit l'offensive afin d'achever l'encerclement et de vaincre les troupes ennemies. Dans la nuit du 28 février, les principales forces du groupe sud des forces armées irakiennes ont été complètement isolées et découpées. Dans la matinée du 28 février, les hostilités dans la zone du golfe Persique ont cessé sous l'effet d'un ultimatum adressé à l'Irak. Le Koweït a été libéré.
Au cours des combats, les forces armées irakiennes ont perdu jusqu'à 60 000 personnes, 358 avions, environ 3 000 chars, 5 navires de guerre et une grande quantité d'autres équipements et armes tués, blessés et capturés. En outre, le potentiel militaire et économique du pays a été gravement endommagé.
La FMN a subi les pertes suivantes : personnel - environ 1 000 personnes, avions de combat - 69, hélicoptères - 28, chars - 15.
La guerre dans le Golfe Persique n’a pas d’analogue dans l’histoire moderne et ne correspond pas aux normes connues des guerres locales. Il s'agissait d'une coalition qui, en termes de nombre de pays participants, dépassait largement les frontières régionales. Le résultat principal fut la défaite complète de l'ennemi et la réalisation des objectifs de guerre en peu de temps et avec des pertes minimes.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS a participé à de nombreux conflits militaires locaux. Cette participation était officieuse et même secrète. Les exploits des soldats soviétiques dans ces guerres resteront à jamais inconnus.
Guerre civile chinoise 1946-1950
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux gouvernements avaient émergé en Chine et le territoire du pays était divisé en deux parties. L’un d’eux était contrôlé par le parti Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, le second par le gouvernement communiste dirigé par Mao Zedong. Les États-Unis ont soutenu le Kuomintang et l’URSS a soutenu le Parti communiste chinois.
Le déclencheur de la guerre fut déclenché en mars 1946, lorsqu'un groupe de 310 000 soldats du Kuomintang, avec le soutien direct des États-Unis, lança une offensive contre les positions du PCC. Ils ont capturé presque tout le sud de la Mandchourie, repoussant les communistes au-delà de la rivière Songhua. Dans le même temps, les relations avec l'URSS commencent à se détériorer - le Kuomintang, sous divers prétextes, ne respecte pas les termes du traité soviéto-chinois « d'amitié et d'alliance » : les biens du chemin de fer chinois de l'Est sont volés, selon les médias soviétiques. sont fermées, des organisations antisoviétiques sont créées.
En 1947, des pilotes, des équipages de chars et des artilleurs soviétiques arrivèrent dans l'Armée démocratique unie (plus tard l'Armée populaire de libération de Chine). Les armes fournies aux communistes chinois par l’URSS ont également joué un rôle décisif dans la victoire ultérieure du PCC. Selon certains rapports, rien qu'à l'automne 1945, l'APL aurait reçu de l'URSS 327 877 fusils et carabines, 5 207 mitrailleuses, 5 219 pièces d'artillerie, 743 chars et véhicules blindés, 612 avions, ainsi que des navires de la flottille Sungari.
En outre, les experts militaires soviétiques ont élaboré un plan de gestion de la défense stratégique et de la contre-offensive. Tout cela a contribué au succès du NAO et à l’instauration du régime communiste de Mao Zedong. Pendant la guerre, environ un millier de soldats soviétiques sont morts en Chine.
Guerre de Corée (1950-1953).
Les informations sur la participation des forces armées de l’URSS à la guerre de Corée ont longtemps été confidentielles. Au début du conflit, le Kremlin n'envisageait pas la participation des troupes soviétiques, mais l'implication à grande échelle des États-Unis dans la confrontation entre les deux Corées a modifié la position de l'Union soviétique. En outre, la décision du Kremlin d’entrer dans le conflit a été influencée par les provocations américaines : par exemple, le 8 octobre 1950, deux avions d’attaque américains ont même bombardé la base de la flotte aérienne du Pacifique dans la région de Sukhaya Rechka.
Le soutien militaire de l'Union soviétique à la RPDC visait principalement à repousser l'agression américaine et consistait en des livraisons gratuites d'armes. Des spécialistes de l'URSS ont formé le personnel de commandement, d'état-major et d'ingénierie.
La principale assistance militaire était fournie par l'aviation : des pilotes soviétiques effectuaient des missions de combat à bord de MiG-15, repeints aux couleurs de l'armée de l'air chinoise. Dans le même temps, il était interdit aux pilotes d'opérer au-dessus de la mer Jaune et de poursuivre les avions ennemis au sud de la ligne Pyongyang-Wonsan.
Les conseillers militaires de l'URSS étaient présents au quartier général du front uniquement en civil, sous le couvert de correspondants du journal Pravda. Ce « camouflage » spécial est mentionné dans le télégramme de Staline au général Shtykov, employé du département d'Extrême-Orient du ministère des Affaires étrangères de l'URSS,
On ne sait toujours pas exactement combien de soldats soviétiques se trouvaient réellement en Corée. Selon les données officielles, au cours du conflit, l'URSS a perdu 315 personnes et 335 chasseurs MiG-15. À titre de comparaison, la guerre de Corée a coûté la vie à 54 246 000 Américains et fait plus de 103 000 blessés.
Guerre du Vietnam (1965-1975)
En 1945, la création de la République démocratique du Vietnam est proclamée et le pouvoir dans le pays passe aux mains du dirigeant communiste Hô Chi Minh. Mais l’Occident n’était pas pressé d’abandonner ses anciennes possessions coloniales. Bientôt, les troupes françaises débarquent sur le territoire vietnamien afin de restaurer leur influence dans la région. En 1954, un document fut signé à Genève, selon lequel l'indépendance du Laos, du Vietnam et du Cambodge était reconnue, et le pays était divisé en deux parties : le Nord-Vietnam dirigé par Ho Chi Minh et le Sud-Vietnam dirigé par Ngo Dinh Diem. Cette dernière perdit rapidement en popularité auprès de la population et une guérilla éclata au Sud-Vietnam, d'autant plus que la jungle impénétrable assurait sa grande efficacité.
Le 2 mars 1965, les États-Unis ont commencé à bombarder régulièrement le Nord-Vietnam, accusant le pays d’étendre le mouvement de guérilla dans le sud. La réaction de l’URSS fut immédiate. Depuis 1965, des livraisons à grande échelle d'équipements militaires, de spécialistes et de soldats au Vietnam ont commencé. Tout s'est passé dans le plus strict secret.
D'après les souvenirs des anciens combattants, avant le départ les soldats étaient habillés en civil, leurs lettres à la maison étaient soumises à une censure si stricte que si elles tombaient entre les mains d'un étranger, celui-ci ne pourrait comprendre qu'une chose : les auteurs se détendaient quelque part dans le sud et profitaient de leurs vacances sereines.
La participation de l'URSS à la guerre du Vietnam était si secrète qu'on ne sait toujours pas quel rôle les militaires soviétiques ont joué dans ce conflit. Il existe de nombreuses légendes sur les pilotes soviétiques combattant des « fantômes », dont l'image collective est incarnée dans le pilote Li-Si-Tsin de la célèbre chanson folklorique. Cependant, selon les souvenirs des participants aux événements, il était strictement interdit à nos pilotes de combattre avec des avions américains. Le nombre exact et les noms des soldats soviétiques ayant participé au conflit sont encore inconnus.
Guerre d'Algérie (1954-1964)
Le mouvement de libération nationale en Algérie, qui a pris de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale, s'est transformé en une véritable guerre contre la domination coloniale française en 1954. L'URSS a pris le parti des rebelles dans le conflit. Khrouchtchev a souligné que la lutte des Algériens contre les organisateurs français était de la nature d’une guerre de libération et qu’elle devait donc être soutenue par l’ONU.
Cependant, l'Union soviétique a fourni aux Algériens plus qu'un simple soutien diplomatique : le Kremlin a fourni à l'armée algérienne des armes et du personnel militaire.
L'armée soviétique a contribué au renforcement organisationnel de l'armée algérienne et a participé à la planification d'opérations contre les troupes françaises, à la suite desquelles ces dernières ont dû négocier.
Les parties ont conclu un accord selon lequel les hostilités ont cessé et l'Algérie a obtenu son indépendance.
Après la signature de l'accord, les sapeurs soviétiques ont mené la plus grande opération de déminage du pays. Pendant la guerre, les bataillons de sapeurs français à la frontière de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie ont miné une bande de 3 à 15 km, où il y avait jusqu'à 20 000 « surprises » par kilomètre. Les sapeurs soviétiques ont déminé 1 350 mètres carrés. km de territoire, détruisant 2 millions de mines antipersonnel.
Confrontation entre les États-Unis et l'URSS. Les guerres régionales et les conflits militaires utilisant des armes conventionnelles se sont poursuivis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.Dans un certain nombre de cas, ils étaient le résultat d’affrontements militaires entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l’URSS, dans diverses parties du globe. Au début des années 1990, le nombre total de morts lors de ces guerres régionales atteignait 17 millions de personnes.
Nous pouvons dire d'avance que ces évaluations seront loin d'être sans ambiguïté, car à côté des réalisations historiques dans le développement de la civilisation terrestre, le XXe siècle a laissé de nombreuses traces sanglantes. Ils sont associés, tout d'abord, à de nombreuses guerres et conflits militaires qui consomment continuellement les fruits du travail humain et plusieurs millions de vies humaines.
La confrontation géopolitique mondiale entre États capitalistes et socialistes dans la seconde moitié du XXe siècle a été appelée la guerre froide. Mais bien souvent, les contradictions entre les systèmes politiques ont donné lieu à des conflits locaux sanglants. Les États-Unis et l’URSS, en tant que dirigeants de leurs blocs respectifs, ont le plus souvent évité une participation militaire à grande échelle, mais il est peu probable que dans les années 1946-1991 il y ait eu un conflit dans lequel les spécialistes militaires des deux côtés n’étaient pas impliqués. Il est donc exagéré de parler de l’absence d’effusion de sang de la guerre froide.
Le premier conflit local de la guerre froide auquel l’armée soviétique a dû participer fut la dernière étape de la guerre civile en Chine de 1946 à 1950. La partie soviétique a soutenu l’armée communiste dirigée par Mao Zedong. Toutes les armes capturées lors de la défaite de l'armée japonaise du Guandong en août 1945 ont été transférées aux communistes chinois. Puis les livraisons d’armes directement soviétiques ont commencé.
Le personnel militaire soviétique a participé à la défense de Shanghai : principalement, l'aviation a repoussé les raids du Kuomintang sur la ville. Au total, il y a eu 238 vols. En outre, des spécialistes militaires soviétiques formaient le personnel militaire chinois. Au total, 936 militaires soviétiques sont morts en Chine entre 1946 et 1950.
L'expérience de participation à la guerre civile en Chine s'est avérée très utile lorsque le conflit entre communistes et partisans du capitalisme s'est également déroulé dans la péninsule coréenne. Pour le résoudre, des troupes américaines ont été envoyées en Corée sous mandat de l’ONU. Dans la situation actuelle, afin d'éviter la perte du pays au profit du bloc socialiste, ce sont principalement des pilotes et des artilleurs anti-aériens qui ont été envoyés.
Au total, entre 1950 et 1953, les pilotes soviétiques ont effectué 63 000 missions de combat et participé à 1 790 batailles aériennes, à la suite desquelles 1 309 avions ennemis ont été abattus. L'Union soviétique a perdu 335 avions en Corée. Les pertes humaines se sont élevées à 315 personnes pendant la guerre.
Le conflit le plus célèbre auquel les spécialistes militaires soviétiques ont participé fut la guerre du Vietnam, dans laquelle ils durent à nouveau affronter les Américains, qui soutenaient également l'une des parties belligérantes dans la guerre civile. Cependant, ici, le personnel militaire soviétique n'a pas directement participé aux hostilités, formant des artilleurs et des pilotes anti-aériens nord-vietnamiens. Ceci explique les faibles pertes au cours des neuf années de guerre (1964-1975) - 16 personnes.
L’un des épisodes les plus célèbres de la guerre froide est la crise des missiles de Cuba en 1962. Cela s'est terminé par un accord mutuel pour retirer les missiles soviétiques de Cuba et les missiles américains de Turquie. Mais une base militaire de l’Union soviétique est restée à Cuba. Alors qu'ils servaient sur « l'île de la liberté », 69 soldats soviétiques sont morts.
Au cours de la même période, les troupes soviétiques subissent des pertes en Algérie, où elles sont envoyées par le gouvernement soviétique pour éliminer les champs de mines laissés par les Français. Le déminage a eu lieu dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, entraînant la mort de 25 spécialistes militaires soviétiques. Lors du déminage - une personne.
Le personnel militaire soviétique a également participé activement au long conflit israélo-arabe. La présence soviétique au Moyen-Orient a atteint son apogée à la fin des années 1960, lorsque, après la destruction complète de la défense aérienne arabe en Égypte par les Juifs, le dirigeant local Abdel Nasser s’est tourné vers l’URSS pour l’aider à la reconstruire. 21 divisions anti-aériennes soviétiques et deux régiments de chasseurs intercepteurs ont été déployés en Égypte. Après la détérioration des relations soviéto-égyptiennes au milieu des années 1970, le contingent fut retiré. Cependant, la présence de spécialistes militaires au Moyen-Orient s’est poursuivie jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique. Au total, 52 soldats soviétiques y sont morts entre les années 1950 et 1980.
Après la chute du système colonial mondial, des forces politiques pro-soviétiques sont arrivées au pouvoir dans de nombreux jeunes États et ont reçu le soutien militaire de l’URSS. Il s’agissait essentiellement de fournir des armes et de former le personnel des forces armées. Mais des pertes au combat ont quand même eu lieu. Par exemple, pendant la guerre somalo-éthiopienne de 1977-1979, les spécialistes militaires soviétiques n'ont pas réussi à éviter une participation directe aux hostilités, à la suite de laquelle deux personnes sont mortes et 31 autres sont mortes de maladies ou de catastrophes d'origine humaine.
Lors de la répression des manifestations antisoviétiques en Hongrie (1956) et en Tchécoslovaquie (1968), 669 et 98 personnes sont mortes respectivement. Il convient de noter qu'en Hongrie, les troupes soviétiques ont dû faire face à une résistance assez forte de la part des forces organisées des rebelles, ce qui a entraîné de lourdes pertes. En Tchécoslovaquie, cela n'a pas été observé, mais 12 des 98 militaires ont été tués à cause des actions de citoyens individuels de la république. Les pertes restantes ont eu des raisons différentes : seules 24 personnes sont mortes à cause d'une manipulation imprudente des armes. Il est intéressant de noter que lors de l'entrée des troupes en Tchécoslovaquie, quatre soldats et un sergent se sont suicidés. Les raisons possibles de cette action sont encore inconnues.
À la fin des années 1960, en raison de la détérioration des relations soviéto-chinoises, deux conflits frontaliers ont eu lieu près de l'île Damansky sur le fleuve Amour et près du lac Zhalanashkol au Kazakhstan - 58 et 2 militaires ont été tués respectivement.
La guerre en Afghanistan, menée par l’Union soviétique de 1979 à 1989, est à part. Il s’agit du premier conflit à grande échelle depuis la Seconde Guerre mondiale auquel l’URSS participe en tant que membre à part entière du conflit. Au total, 15 051 citoyens soviétiques sont morts en Afghanistan, dont 14 425 ont été tués directement par l'armée.
Avec l’effondrement de l’URSS, la guerre froide prend fin. Les pertes du côté soviétique dans ce conflit, hors guerre en Afghanistan, se sont élevées à 2 402 personnes.
Chronique des actions militaires de l'URSS. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales actions militaires menées à la fois directement par l'URSS et avec sa participation contre ses voisins les plus proches pour « nos intérêts » dans les décennies d'après-guerre. Le 21 mai 1991, le journal Krasnaya Zvezda a publié, avec l'autorisation du ministère de la Défense de l'URSS, une liste loin d'être complète des pays où des militaires soviétiques - « guerriers internationalistes » - ont pris part aux hostilités, indiquant l'heure des combats. .
1948 – « siège » de Berlin-Ouest. Blocage par les troupes soviétiques des liaisons de transport terrestre entre l'Allemagne et Berlin-Ouest.
1950-1953 - Guerre de Corée.
1953 – Les troupes soviétiques répriment le soulèvement en RDA.
1956 – Les troupes soviétiques répriment la révolution anticommuniste en Hongrie.
1961 - construction du mur de Berlin de 29 kilomètres en une nuit du 13 août. Crise berlinoise.
1962 - importation secrète à Cuba de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques à tête nucléaire. Crise des Caraïbes.
1967 - participation de spécialistes militaires soviétiques à la « guerre des sept jours » entre Israël et l'Égypte, la Syrie et la Jordanie.
1968 - Invasion des troupes de l'URSS, de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie en Tchécoslovaquie.
1979 - entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Le début de la guerre afghane de dix ans.
Juin 1950 - juillet 1953 Corée du Nord,
1960-1963, août 1964-novembre 1968, novembre 1969-décembre 1970 Laos,
1962-1964 Algérie,
18 octobre 1962 - 1er avril 1963, 1er octobre 1969 - 16 juin 1972, 5 octobre 1973 - 1er avril 1974 Égypte,
18 octobre 1962 - 1er avril 1963 Yémen,
1er juillet 1965-31 décembre 1974 Vietnam,
5-13 juin 1967, 6-24 octobre 1973 Syrie,
Avril-décembre 1970 Cambodge,
1972-1973 Bangladesh,
Novembre 1975-1979 Angola,
1967-1969, novembre 1975-novembre 1979 Mozambique,
9 décembre 1977 - 30 novembre 1979 Éthiopie,
1980-1990 Nicaragua - Salvador,
1981 à 1990 Honduras,
Outre les opérations militaires connues dans le monde entier avec la participation officielle de l'armée soviétique, soit sous forme de « campagnes de libération », soit dans le cadre d'un « contingent limité de troupes », nos « guerriers internationalistes » en tenue civile ou en uniforme d'« indigènes », ou encore dans des chars et des avions repeints, ils figuraient dans les rangs de l'armée dans plus de vingt pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
La Seconde Guerre mondiale n’est pas le point final du développement de la confrontation armée. Selon les données statistiques, les troupes de l'URSS ont participé directement à une trentaine de guerres locales, tant sur le territoire de l'État qu'au-delà de ses frontières territoriales. De plus, la forme de participation était à la fois indirecte et directe.
Que sont les guerres locales
La politique étrangère et intérieure d’un État peut être menée selon diverses méthodes. Certains recourent au règlement pacifique des questions controversées, d’autres à la confrontation armée. En parlant de conflit militaire, il convient de noter qu’il s’agit d’une politique menée à l’aide d’armes modernes. Un conflit armé comprend toutes les confrontations : affrontements à grande échelle, guerres interétatiques, régionales, locales, etc. Examinons ces dernières plus en détail.
Les guerres locales ont lieu entre un cercle limité de participants. Dans la classification standard, ce type de confrontation implique la participation de deux États qui poursuivent certains objectifs politiques ou économiques dans cette confrontation. Dans le même temps, le conflit militaire se déroule uniquement sur le territoire de ces sujets, affectant et violant leurs intérêts. Ainsi, les guerres locales et les conflits armés sont des concepts spécifiques et généraux.
| Nom du conflit armé | date |
| en Chine | 1946-1950 |
| guerre de Corée | 1950-1953 |
| Crise hongroise | 1956 |
| Guerre au Laos | 1960-1970 |
| Déminage des territoires de l'État algérien | 1962-1964 |
| Crise des Caraïbes | 1962-1963 |
| Guerre civile au Yémen | 1962-1969 |
| La guerre du Vietnam | 1965-1974 |
| Conflits du Moyen-Orient | 1967-1973 |
| Crise tchécoslovaque | 1968 |
| Guerre civile au Mozambique | 1967, 1969, 1975-79 |
| Guerre en Afghanistan | 1979-1989 |
| Conflit tchado-libyen | 1987 |
Le rôle de l'URSS dans la guerre de Corée
Conflits locaux de la guerre froide, le tableau des dates historiques comprend les plus diverses. Cependant, cette liste s'ouvre de 1950 à 1953. Cette guerre est une confrontation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Le principal allié de la Corée du Sud fournissait à l'armée les équipements les plus récents. De plus, les États-Unis ont dû former 4 divisions offensives pour soutenir leur allié coréen.
L’URSS a d’abord pris une part passive au conflit armé, mais après que les plans secrets américains furent connus, la phase de guerre prit une direction plus active. L'URSS a non seulement soutenu la RPDC, mais a également prévu de transférer son propre contingent sur le territoire de son allié.

Selon les données officielles, les pertes de l'armée soviétique dans ce conflit ont atteint entre 200 et 500 000 hommes. Les vétérans des guerres locales, notamment en Corée, ont reçu le titre honorifique de Héros de l'URSS. Parmi les personnalités les plus célèbres figurent Evgeniy Georgievich Pepelyaev et Sergei Makarovich Kramarenko, qui ont fait preuve d'une bravoure et d'un courage sans limites.
Le rôle de l'URSS dans la guerre du Vietnam
En parlant des guerres russes, nous ne devons pas oublier le rôle de l’État soviétique dans la guerre du Vietnam. Le conflit militaire remonte à 1959-1975. Le déterminant du conflit était la revendication de la République du Vietnam sur le territoire de la République démocratique du Vietnam. Avec toute l'aide possible des États-Unis, qui ont fourni du matériel et des ressources financières, les sudistes ont lancé des opérations punitives sur le territoire de l'État voisin.
En 1964, les États-Unis commencèrent à participer activement au conflit armé. Un contingent américain colossal a été transféré sur le territoire du Vietnam, qui a utilisé des armes interdites dans la lutte contre l'ennemi. Lors de l'utilisation du napalm biologique, des bombardements de zones résidentielles ont été effectués, causant de nombreuses victimes parmi la population civile.

Malgré les efforts des forces patriotiques, la bataille aérienne contre les États-Unis fut perdue. L’assistance stratégique et militaire de l’URSS a permis de redresser la situation. Grâce à ce soutien, la défense aérienne a été déployée, ce qui a permis de transférer les guerres locales au Vietnam vers une forme plus passive. À la suite de la guerre, un État unique a été recréé, appelé la République socialiste du Vietnam. La date définitive pour la fin de la confrontation est considérée comme le 30 avril 1975.
Nikolai Nikolaevich Kolesnik, sergent de l'armée soviétique, ainsi que les lieutenants supérieurs Vladimir Leonidovich Boulgakov et Valentin Nikolaevich Kharin, se sont distingués dans le conflit vietnamien. Les combattants ont reçu l'Ordre du Drapeau Rouge.
Le rôle de l'URSS dans le conflit du Moyen-Orient
La confrontation israélo-arabe est le plus long conflit local de la guerre froide. Le tableau des dates indique que la confrontation n'est pas terminée jusqu'à aujourd'hui, se manifestant périodiquement par des batailles acharnées entre États.
Le début du conflit remonte à 1948, après la création du nouvel État d’Israël. Le 15 mai, un affrontement armé a eu lieu entre Israël, dont les États-Unis étaient l'allié, et des pays arabes soutenus par l'URSS. Le conflit principal s'est accompagné du transfert de territoires d'un État à un autre. Ainsi, Israël a notamment pu s'emparer de la province de Jordanie, importante d'un point de vue religieux pour les Palestiniens.

L'URSS a joué le rôle le plus actif dans ce conflit. Ainsi, à la demande de hauts responsables des pays arabes, l’Union soviétique a fourni une assistance militaire importante aux pays alliés. Une division de défense aérienne a été déployée sur le territoire des États, grâce à laquelle il a été possible de freiner l'assaut d'Israël et des États-Unis. En conséquence, Popov K.I. et Kutyntsev N.M. ont été nominés pour leur bravoure et leur courage au grade
Le rôle de l'URSS dans la guerre en Afghanistan
L'année 1978 est marquée par un coup d'État en Afghanistan. Le Parti démocrate, soutenu de toutes les manières possibles par l'Union soviétique, est arrivé au pouvoir. L’objectif principal a été de construire un socialisme à l’image de l’URSS. Cependant, de tels événements ont suscité une réaction négative parmi la population locale et le clergé musulman.
Les États-Unis ont fait contrepoids au nouveau gouvernement. C’est avec l’aide américaine que fut créé le Front national de libération de l’Afghanistan. Sous leurs auspices, de nombreux coups d'État ont été perpétrés dans les plus grandes villes de l'État. Ce fait a provoqué une nouvelle guerre russe en Afghanistan.

Selon des preuves, l'Union soviétique a perdu plus de 14 000 personnes dans la guerre en Afghanistan. 300 soldats sont portés disparus. Environ 35 000 personnes ont été grièvement blessées lors de violents combats.
Caractéristiques des conflits locaux pendant la guerre froide
En résumé, nous pouvons tirer quelques conclusions.
Premièrement, toutes les confrontations armées étaient de nature coalition. En d’autres termes, les parties belligérantes ont trouvé des alliés en la personne de deux puissances hégémoniques majeures : l’URSS et les États-Unis.
Deuxièmement, lors des conflits locaux, des méthodes de guerre plus modernes et des armes uniques ont commencé à être utilisées, ce qui a confirmé la politique de « course aux armements ».
Troisièmement, toutes les guerres, malgré leur caractère local, ont entraîné d’importantes pertes économiques, culturelles et humaines. Les États participant aux conflits ont été longtemps ralentis dans leur développement politique et économique.